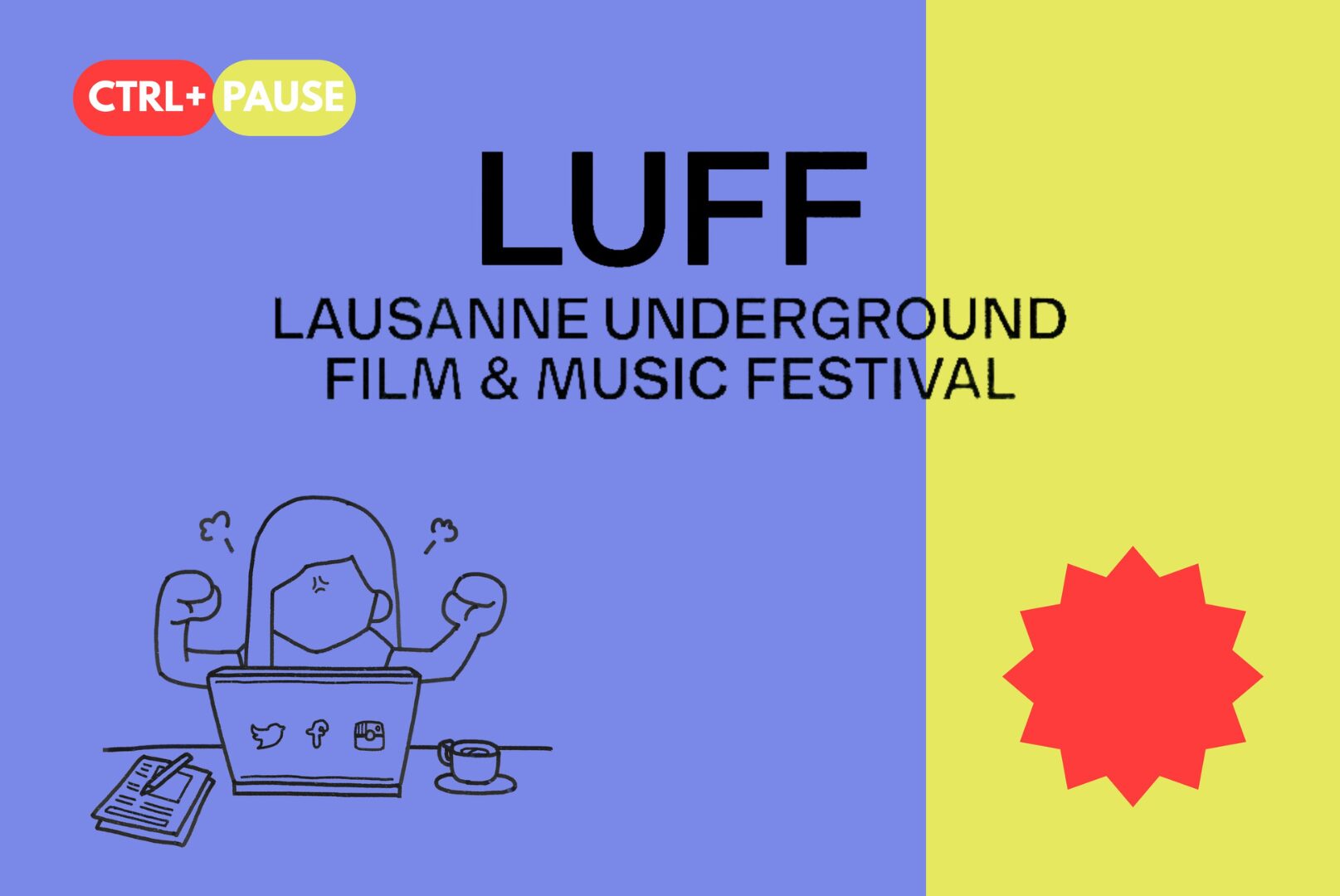Publier pour être visible, liker pour exister. Dans la culture, la communication numérique s’impose comme un passage obligé, au risque d’être déconnectée des valeurs de l’entité. Le LUFF, le Lausanne Underground Film & Music Festival, fait partie des structures qui réfléchissent à des alternatives. Mais sortir du cadre reste un acte fragile, tant les règles du jeu semblent verrouillées. Entretien avec sa co-directrice, Marie Klay.
Fatigue numérique : symptôme d’un modèle à bout de souffle
Stories à la chaîne, publications calibrées, algorithmes insatiables… La communication numérique est devenue une course à l’épuisement. La “visibilité” devient une contrainte, qui, dans certains cas, peu être déconnectée du sens même des projets.
Des analyses, comme cet article de Camille Rondot pour la revue Balisages ou ce rapport du ministère de la Culture du Québec, montrent que les institutions culturelles subissent une pression à la visibilité qui influence profondément leurs pratiques de communication. Ainsi, la communication du secteur culturel fait face à des tensions entre exigences de visibilité et valeurs culturelles.
Toutefois, comment sortir du feed et communiquer autrement ? Bien que cela soit plus facile à dire qu’à faire, certaines institutions culturelles y réfléchissent sérieusement.
LUFF : un festival à contre-courant
C’est le cas du LUFF qui, en 2019, lance Power OFF, une programmation musicale en marge du festival, volontairement sans technologie ni électricité. Si cette initiative se voulait d’abord écologique, elle traduisait aussi une volonté de questionner la dépendance aux outils numériques dans l’expérience culturelle, tant du côté de la scène que de la communication. Marie Klay explique que cette réflexion a été approfondie depuis, notamment en cohérence avec les enjeux actuels de la fatigue numérique.
L’événement avait notamment été couvert dans un article de Cécile Détraz pour JAM, qui revenait sur la portée symbolique de cette programmation.
En 2024, l’édito du LUFF défend une approche globale : faire culture autrement, refuser la concurrence systématique, la productivité à outrance et les outils qui uniformisent. Il propose aussi de revoir le lien au public, en “l’accueillant en allié.e.x.s plutôt qu’en client.e.x.s”.
“On essaie de contrer la logique de consommation culturelle. Pas besoin de tout voir, mais de vivre une vraie expérience. Et ça passe aussi par notre façon de communiquer, car aujourd’hui, on est noyé sous les messages et tout le monde essaie d’hurler un peu plus fort.”, souligne Marie Klay.
Cette posture s’exprime également dans leur manière de repenser la communication: moins de mise en scène, moins de pression à publier, davantage de lien, d’authenticité et de cohérence avec les valeurs du festival:
“Instagram n’est peut-être plus une plateforme qui nous correspond. Il faudrait peut-être admettre à un moment que ce canal ne correspond plus à notre manière de faire.” Marie Klay
Tensions et expérimentations
Marie Klay observe une grande fatigue dans la profession : “Beaucoup de responsables com’ démissionnent, usés de répéter les mêmes choses sans en voir le sens.” Elle décrit un quotidien où le festival tente de suivre les tendances dictées par les plateformes, sans jamais atteindre une vraie satisfaction :
“On a l’impression de faire une com’ bancale. On court après ce qui marche, ce que les algorithmes mettent en avant, et on n’est jamais satisfaits. C’est devenu un boulot à plein temps, difficile et souvent ingrat.” Marie Klay.
Face à cette réalité, le LUFF aimerait tester des alternatives concrètes, accessibles et plus sobres comme des catalogues à imprimer chez soi pour limiter le superflu, un site web comme point d’information unique et surtout une implication directe du public dans la communication.
“Je voulais proposer à notre public de nous prêter leur projecteur à la maison. On leur fournirait des teasers ou des visuels qu’il pourrait projeter sur la façade d’en face, à une heure donnée, créant ainsi une forme de diffusion participative et locale.” Marie Klay
A côté de ces idées participatives, le bouche-à-oreille garde toujours toute sa force. Selon elle, la meilleure promotion possible reste celle faite par l’équipe elle-même. En effet, “plus elle comprend l’événement, plus elle en parle et à chaque roulement c’est le public qui change. C’est vivant.”, explique-t-elle.
Du côté numérique, le LUFF explore les pistes d’autres canaux comme Bluesky ou Mastodon. Ces plateformes, moins centralisées et moins orientées vers la publicité ou les contenus sponsorisés, pourraient offrir un espace de communication plus respectueux du rythme et des valeurs du festival. Mais là aussi, la prudence est de mise :
“Il y a un vrai risque de simplement déplacer la dépendance d’une plateforme à une autre, sans résoudre le fond du problème.” Marie Klay
Pourquoi est-ce si difficile ?
Pourtant, ces initiatives se heurtent à un environnement peu adapté à ce type de démarches: algorithmes changeants, manque de moyens, pression financière.
En tant que structure culturelle, le festival subit des attentes institutionnelles croissantes, notamment en matière de communication numérique. Être actif sur les réseaux sociaux est souvent vu comme une preuve de dynamisme, parfois avec des injonctions déconnectées du terrain, comme “allez sur TikTok”, sans lien réel avec sa ligne artistique.
Marie Klay décrit que ces exigences servent souvent plus à cocher des cases qu’à valoriser véritablement le travail accompli. Elle révèle ainsi également un écart croissant entre logiques institutionnelles et réalité des structures indépendantes.
Le problème est plus large: c’est un système entier qui valorise la performance. Subventions liées à la fréquentation et injonction à se plier aux formats imposés… Même quand on les critique, il est difficile d’en sortir. Une réflexion qui interroge plus largement les critères de réussite dans la culture.
“Tant qu’on mesure la réussite en likes ou en partages, les démarches alternatives resteront marginales. Il faudrait qu’on nous finance pour réfléchir, tester, ralentir, développer… mais ce temps-là, on ne l’a jamais.” Marie Klay
Montrer la voie : un rôle pour la culture et la CIG ?
Sortir du feed, ce n’est pas renoncer à communiquer, mais chercher une autre voie: plus lente, plus réfléchie, plus fidèle au sens des projets. Le LUFF essaie de faire différemment. Mais au vu de cet entretien, nous comprenons bien que pour le festival, tant que les logiques dominantes restent celles de la croissance, de la performance, du “plus de monde, plus de vues, plus de présence”, les tentatives de faire autrement risquent de rester marginales, voire intenables à long terme.
Selon Marie Klay, même si la culture se doit de mettre en avant le débat, la remise en question du modèle devrait venir de toute la société. Cette transition ne peut reposer uniquement sur les épaules des structures culturelles.
Les politiques publiques doivent reconnaître, financer et valoriser des formes de communication affranchies des logiques marchandes et concurrentielles. Car changer notre manière de communiquer, c’est déjà commencer à transformer nos manières de faire société. À condition de soutenir celles et ceux qui osent sortir du cadre.
Pour finir, nous vous proposons quelques structures culturelles qui ont piqué notre curiosité de par leur façon de communiquer tant sur que hors des réseaux sociaux. À ce sujet, l’article de Jeanne Mazzarella sur le Slow Content propose une approche alternative de la création de contenu, plus réfléchie et en rupture avec les logiques de performance imposées par les plateformes.
Crédits Photos :
Photo de Marie Klay – ©Miguel Bueno/NIFF
Photo Infographie 2 (de gauche à droite) – ©Le Bus des Curiosités, ©Céline Michel, ©Roman Devuyst
À lire aussi…