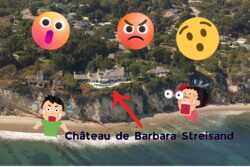Perçue comme un outil des politiques de diversité, d’égalité et d’inclusion (DEI), l’écriture inclusive semble aujourd’hui perdre en popularité. Amnesty International, organisation majeure dans la défense des droits humains, persiste dans son usage. Un choix qui soulève un dilemme stratégique: rester fidèle à ses valeurs au risque de se priver de certains publics.
2025: la fin d’un contexte politique propice à l’inclusion
L’élection d’un président américain ouvertement opposé aux politiques DEI est le symbole d’un tournant politique et sociétal. Des entreprises comme Disney réduisent leur recours à l’inclusivité, afin de ménager une partie de leur clientèle.
En Suisse aussi, le langage inclusif suscite des débats. À Zurich, une votation populaire au résultat serré a récemment suivi la décision de la commune de rédiger l’ensemble de ses documents officiels en écriture inclusive. Le langage inclusif devient ainsi un véritable enjeu de communication stratégique.
Le cas d’Amnesty Suisse se révèle particulièrement intéressant. S’agissant d’une organisation mondialement reconnue, ses pratiques pourraient bien influencer celles de plus petites entités. Sa porte-parole nous a confirmé la position d’Amnesty Suisse : l’institution ne reviendra pas sur un principe fondamental, encore moins pour une organisation dont la mission première est la défense des droits humains.
Une position ancrée et revendiquée
En Suisse, où Amnesty opère dans un environnement multilingue, le recours au langage inclusif s’inscrit dans une démarche engagée de longue date. Depuis plus de vingt ans, l’organisation veille à intégrer systématiquement la dimension féminine dans ses publications. Et depuis cinq ans, la non-binarité y trouve aussi sa place.
Cette évolution n’est pas improvisée : elle s’appuie sur une politique interne formalisée, un guide des bonnes pratiques, et des formations continues pour les équipes. L’organisation assume sa trajectoire. Elle refuse de revenir sur ses acquis, même dans un climat international devenu plus hostile. Plus encore, elle revendique un rôle moteur : en maintenant cette ligne, Amnesty veut fédérer autour des droits humains, dont les principes d’inclusion font partie, et montrer la voie à d’autres associations, peut-être moins visibles ou moins armées face aux pressions extérieures.
Entre cohérence éthique et impact stratégique
Ce choix n’est pas sans conséquences. Selon Swissinfo, l’écriture inclusive « échauffe les esprits», surtout en dehors des cercles déjà convaincus. Certains publics s’arrêtent au style, sans aller au fond du message. Par ces détracteurs, elle est perçue comme une manière de dénaturer la langue mais aussi comme une marqueur idéologique fort. Et dans un monde saturé de contenus, chaque obstacle de lecture est un frein potentiel à la mobilisation.
Mais Amnesty est prête à assumer ce coût. En mettant la cohérence avec ses valeurs au-dessus de la recherche du consensus, l’organisation hiérarchise ses priorités : rester fidèle à sa mission de défense des droits humains, même si cela implique une audience plus restreinte. Amnesty estime que si, malgré des explications claires et argumentées, certains restent opposés à l’écriture inclusive, il ne lui appartient plus de les convaincre. « On ne peut pas plaire à tout le monde. Il s’agit de faire ce qui est le plus juste au niveau des droits humains » nous a confié sa porte-parole en réponse.
Une voie affirmée
L’exemple d’Amnesty Suisse met en lumière les tensions stratégiques auxquelles peuvent être confrontées les organisations engagées : entre fidélité à leurs principes et attention portée aux réactions d’un public plus large et critique. Dans un contexte où l’écriture inclusive fait l’objet de discussions croissantes, l’organisation a choisi de maintenir sa ligne éditoriale qu’elle juge en cohérence avec ses valeurs fondatrices. Son cas trace ainsi une voie : celle de l’affirmation.
Bibliographie :
-
Degott, C. (2024, 12 novembre). Une initiative veut interdire l’usage de l’écriture inclusive par la Ville de Zurich. RTS. https://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/2024/article/une-initiative-veut-interdire-l-usage-de-l-ecriture-inclusive-par-la-ville-de-zurich-28691144.html
-
Degott, C. (2025, 21 février). Disney fait marche arrière concernant sa politique de diversité et d’inclusion. RTS. https://www.rts.ch/info/culture/2025/article/disney-recule-sur-la-diversite-et-allege-ses-avertissements-controverses-28797412.html
- O’Sullivan, D. (2021, 8 juin).Pourquoi l’écriture inclusive échauffe les esprits. SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/fre/politique/l-%C3%A9criture-inclusive-subira-t-elle-le-verdict-des-urnes/46676792
- Association « Défense du français ». (s.d.). Identifier les menaces. https://www.defensedufrancais.ch/l-association/identifier-les-menaces/
À lire aussi…