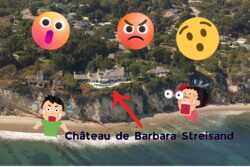En 2025, la sursollicitation sur les réseaux sociaux épuise les publics. Une question se pose alors pour les communicants et les communicantes d’intérêt général : comment informer sans contribuer à cette fatigue numérique ? Le slow content apparaît comme une alternative. Mais est-ce vraiment stratégique d’être slow sur les réseaux sociaux ?
« Starter pack » : quand le numérique épuise
Vidéos express, surexposition à l’intelligence artificielle, fake news, tendances éphémères, scroll infini : autant d’éléments qui alimentent la saturation des publics sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook ou TikTok. À force de consommer des snack contents, ces formats courts, rapides, peu coûteux à produire et taillés pour l’algorithme (Vincent, Poirier & Dupont), les utilisateurs et utilisatrices s’épuisent.
Un exemple actuel de ce type de contenus : le « starter pack ». Cette tendance, qui a rapidement envahi les réseaux sociaux, consiste à créer des figurines numériques grâce à l’intelligence artificielle. Elles sont accompagnées d’objets censés représenter celui ou celle qui les génèrent (voir les exemples ci-dessous).
Un format décliné par des milliers d’internautes, mais aussi par des marques ou même des personnalités politiques (Blick). Facile à produire, visuel, répétitif, le « starter pack » coche toutes les cases du snack content. Résultat : les fils d’actualités se ressemblent tous, les formats perdent leur effet de surprise, et les publics, saturés, finissent par s’épuiser.
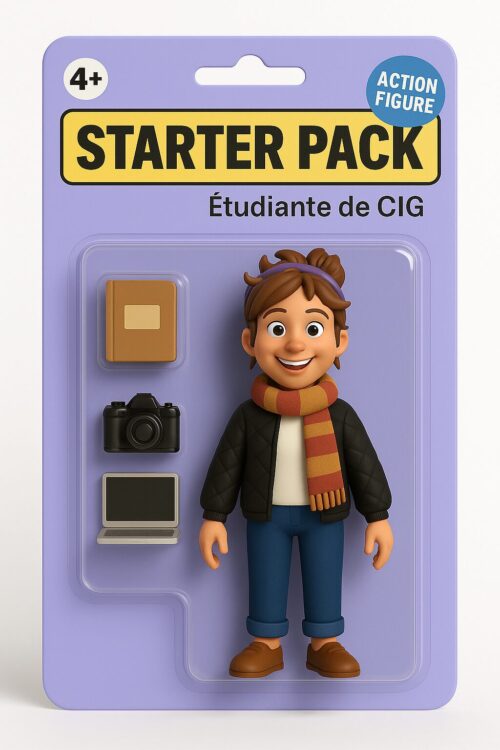
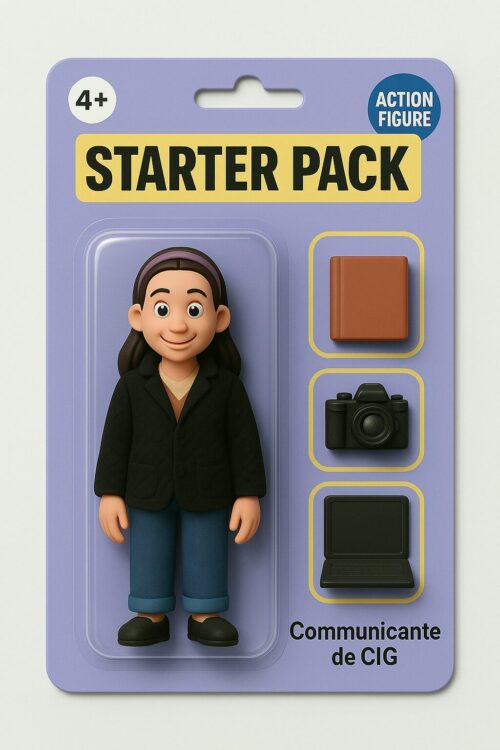
Une alternative ? Le slow content
À rebours des logiques du snack content, le slow content s’appuie sur des contenus moins fréquents, mais plus approfondis. Selon Vincent, Poirier & Dupont, il valorise la qualité plutôt que la quantité, la pertinence plutôt que l’instantanéité. Le but est de produire des contenus durables capables de rester pertinents dans le temps.
À ce titre, Gaël Hurlimann évoque le podcast Brise-Glace du journal Le Temps, produit par Célia Héron et Virginie Nussbaum.
Une stratégie à contre-courant des algorithmes
Mais cette ambition se heurte à un obstacle majeur : le modèle de l’économie de l’attention. Comme le souligne le sociologue Romain Badouard, les plateformes numériques sont conçues pour capter et retenir l’attention des utilisateurs et utilisatrices. Plus on passe de temps en ligne, plus on est exposé à la publicité, et plus les plateformes génèrent du revenu.
Selon Farchy & Tallec, les algorithmes mettent donc en avant les contenus qui captent l’attention et génèrent le plus d’engagement : les contenus émotionnels, polarisants ou simplifiés. Autrement dit, tout ce qui est contraire au slow content.
Gaël Hurlimann le résume bien : « On perd avec le slow content ce truc très addictif, qui est d’ailleurs provoqué exprès pour maintenir les utilisateurs en activité : le feedback, l’adrénaline des notifications pour un like ou un commentaire. »
Cela pose donc une tension de fond : peut-on vraiment rester pertinent et visible sans jouer le jeu des algorithmes ?
S’adapter … ou changer de terrain
Pour Gaël Hurlimann, il faut être lucide : « Utiliser un réseau sans ‘jouer le jeu’ de l’algorithme, je n’y crois pas. Mieux vaut ne pas perdre de temps et accepter de disparaître quand un changement d’algorithme fait que vous n’y trouvez plus votre compte. »
Il reconnaît aussi que certains réseaux ne sont tout simplement pas conçus pour accueillir la slow communication :
« Tenter de faire fonctionner un contenu slow sur une plateforme pensée pour le doomscrolling (le fait de scroller de façon compulsive des contenus anxiogènes), et un temps moyen passé sur un post de 5 à 10 secondes, c’est inutile. »
Mais tout n’est pas perdu ! Comme Gaël Hurlimann nous l’explique, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls canaux à la disposition des communicants et communicantes d’intérêt général. D’autres supports comme la newsletter, le site web, ou le podcast, offrent un espace propice pour le slow content.
De même, contrairement à des réseaux comme TikTok, Instagram, X (ex-Twitter) ou Facebook conçus pour le snack content, certaines plateformes, telles que LinkedIn ou YouTube, permettent d’être plus slow.
Toujours rester stratégique
Selon Gaël Hurlimann, l’important est de rester stratégique. Être présent sur les réseaux, oui, mais pas à n’importe quel prix. Avant de s’y engager, il faut évaluer deux choses : est-ce que mon public cible est présent ? Et est-ce que l’algorithme me permet de faire passer mon message ? Si la réponse est doublement positive, alors l’investissement en vaut la peine. Sinon, il faut savoir mettre une plateforme en pause ou l’abandonner.
Selon lui, la clé réside dans une forme d’équilibre :
« Pour moi, selon votre stratégie de communication, les deux formes de contenus peuvent avoir de l’intérêt : pourquoi pas du fast content pour se faire connaître, ou même se faire plaisir, avec toutes les mécaniques addictives des plateformes ; et pourquoi pas faire du slow content pour approfondir, en acceptant qu’on n’aura pas le même ‘feedback loop’ (retour immédiat) et qu’il faudra faire sans ce côté addictif. »
Finalement, la solution pour rester pertinent sans saturer les publics n’est peut-être pas de bannir complètement le fast au profit du slow, mais bien de faire cohabiter les deux intelligemment en trouvant le bon tempo et le bon canal pour son message.
- Slow Content.org (site en anglais)
- Wild & Slow:
- “Osez le slow en entreprise”
À voir aussi
Bibliographie
Badouard, R. (2017). Le désenchantement d’Internet. Désinformation, rumeur et propagande. FYP éditions.
Blick. (10.04.2025).”Cette tendance inoffensive générée par l’IA pourrait causer notre perte”. https://www.blick.ch/fr/suisse/starter-pack-cette-tendance-de-lia-pourrait-causer-notre-perte-id20768552.html
Canevet, F., Gambetto, G. et Zongo-Martin, O. (2024).Semaine 4. Devenez incontournable grâce au content hacking. Le Growth Hacking (pp. 129-163). Dunod. https://shs.cairn.info/le-growth-hacking-3e-ed–9782100872800-page-129?lang=fr.
Farchy, J. & Tallec, S. (2023). De l’information aux industries culturelles, l’hypothèse chahutée de la bulle de filtre. Questions de communication, 43(1), 241-268. https://shs.cairn.info/revue-questions-de-communication-2023-1-page-241
Interview avec Gaël Hulrimann, faite le 30 avril 2025.
Vincent, H., Poirier, D. et Dupont, K. (2021). 6. Les outils du slow content. Osez le slow en entreprise : Les clés du design et du marketing pour créer une entreprise durable (pp. 167-189). Dunod. https://shs.cairn.info/osez-le-slow-en-entreprise–9782100815128-page-167?lang=fr.