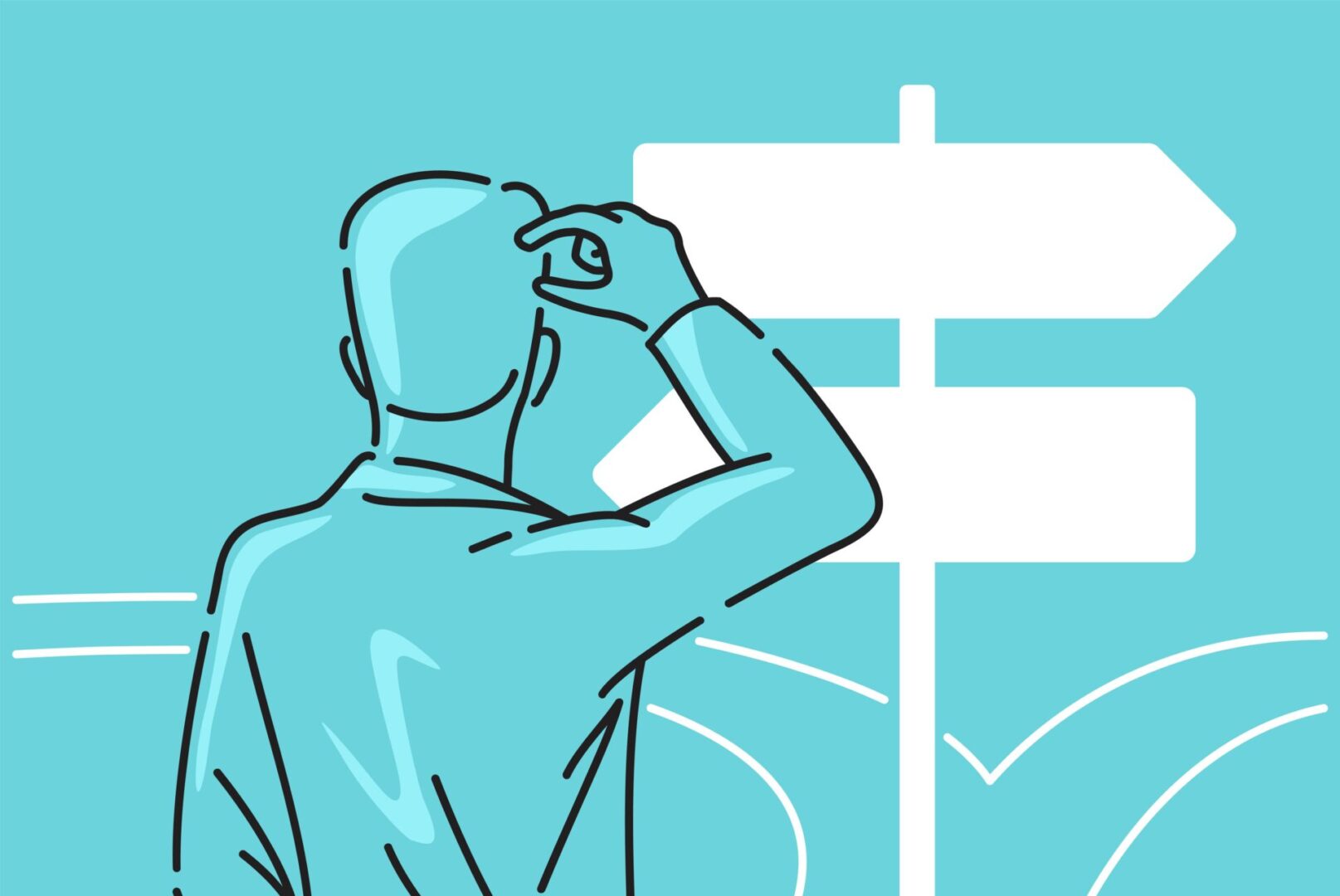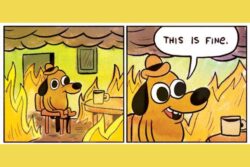Dans un contexte européen en mutation, certaines organisations indépendantes décident de s’engager dans le jeu partisan. L’action des communicants et communicantes est mise sous pression : faire preuve d’impartialité, ce n’est pas toujours être moralement juste.
En 2025, le paysage politique européen se caractérise par la progression de partis politiques qualifiés d’extrême droite, comme le rapportent The Economist et The Wall Street Journal. Bien que cette ascension ne soit ni linéaire ni uniforme, elle alarme de nombreuses institutions d’intérêt général, qui jugent nécessaire d’alerter l’opinion publique.
Face à cette situation, les organisations adoptent des postures variées : certaines choisissent de s’exprimer publiquement, y compris en appelant à voter contre des partis spécifiques ; d’autres préfèrent rester silencieuses pour préserver leur neutralité.
En France, 400 associations et syndicats ont fait barrage au RN
Lors du premier tour des législatives de 2024, marqué par la percée du Rassemblement National, plusieurs organisations ont appelé à voter pour le Nouveau Front Populaire, moins par adhésion partisane, que pour empêcher l’élection d’un parti qu’elles qualifient d’extrême droite.
Parmi elles, de nombreuses organisations d’intérêt général, telles que la Ligue des droits de l’Homme, la Confédération Générale du Travail (CGT), et APF France handicap ont signé un appel commun invitant à faire barrage au RN. Elles estimaient que son élection aurait compromis les perspectives d’égalité et de justice en France, et les intérêts du public qu’elles représentent.
Ces organisations ont décidé de faire entorse au principe d’indépendance politique au nom de la défense des droits fondamentaux ; ce choix peut s’analyser à travers l’éthique de la vertu, dans la mesure où il s’appuie sur la motivation de rester fidèle à ses principes, comme l’explique Valérie Gorin, Head of Learning at the Geneva Center of Humanitarian Studies (CERAH).
Selon elle, les organisations doivent s’aligner sur leurs valeurs et se demander si, quelles qu’en soient les conséquences, il ne leur incombe pas une responsabilité morale de réagir.
Ce n’est pas leur intention au départ de cibler des éléments qui font partie du programme de la droite. Mais en l’occurrence, ce sont des valeurs qu’ils défendent, et qui viennent en opposition avec le programme d’un parti politique. S’ils ne défendaient pas ces valeurs […] ce serait quelque part se désavouer soi-même. (Valérie Gorin, interview réalisée le 2 mai 2025)
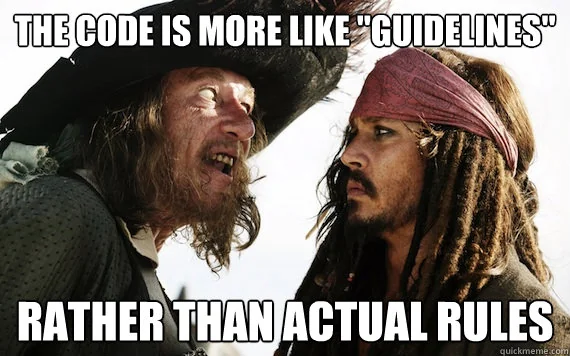
« Il est impossible de rester neutre devant la menace »
Parmi les organisations intervenues dans les élections législatives, certaines revendiquent une neutralité confessionnelle et une indépendance des partis politiques, comme indiqué sur leur site par APF France handicap, la LDH ou la CGT. Elles ne devraient pas intervenir en faveur ou en défaveur d’un parti politique et, pourtant, elles l’ont toutes fait.
Dans un article du Point, le journaliste Nicolas Guarinos explique que l’enjeu de ces prises de position n’est pas d’influencer le vote, mais de défendre leurs valeurs sans donner l’impression de soutenir une idéologie politique.
Nous ne sommes pas partisans […] mais il est impossible de rester neutre devant la menace, tant ce que nous représentons est incompatible avec ce qu’est et ce qu’annonce le RN. (Jerôme Saddier, président sortant d’ESS France, Carenews)
D’autres organisations ont préféré ne pas prendre position
Les syndicats n’ont pas adopté une position unifiée. Dans leurs communiqués, la CGT et la FSU ont clairement appelé à faire barrage au Rassemblement national, tandis que, d’après Le Monde, les confédérations CFE-CGC, la CFTC et FO sont restées neutres.
« Nous ne donnons jamais de consigne, nous ne faisons pas de politique partisane.» (Cyril Chabannier, président de la CFTC, dans une interview pour le Point).
L’Union des Entreprises de Proximité (U2P) a également maintenu une ligne de neutralité stricte. Elle a rappelé à France Info que, n’étant pas un parti politique, elle ne donnerait pas de consigne de vote. L’U2P n’a formulé aucun commentaire sur l’élection du Nouveau Front populaire au second tour, tandis qu’en comparaison, la CGT a salué l’éviction du RN comme une victoire pour la République et la démocratie.
L’inaction doit être moralement défendable
En Suisse, les institutions qui s’écartent de la neutralité politique pour prendre position contre l’extrême droite sont plus rares. Valérie Gorin l’explique par le fait qu’un certain seuil de sensibilité morale n’a pas encore été franchi ; en France, il semble bien dépassé.
Selon Valérie Gorin, prendre publiquement position, c’est toujours risquer de déplaire à une partie de son audience, de cliver le débat, voire de perdre en légitimité. Pour qu’une organisation accepte ce risque, il faut que l’inaction paraisse éthiquement encore moins défendable. Autrement dit, que rester neutre devienne moralement insoutenable.
Pour aller plus loin :